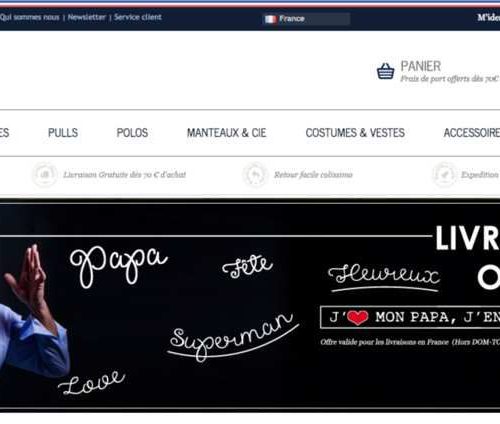Un tournant décisif dans l’histoire de l’internet moderne et bouleverser l’écosystème publicitaire numérique mondial.
La tech américaine connaît un nouveau séisme judiciaire. Google, le géant de Mountain View, vient d’être déclaré coupable d’avoir monopolisé le marché de la publicité en ligne aux États-Unis par une juge fédérale.

Cette décision historique, rendue publique ce jeudi dans un document de 115 pages, pourrait marquer un tournant décisif dans l’histoire de l’internet moderne et bouleverser l’écosystème publicitaire numérique mondial.
La juge fédérale Leonie Brinkema n’a pas mâché ses mots.
Selon elle, les plaignants ont démontré que Google avait « sciemment entrepris une série d’actions anticoncurrentielles pour atteindre et conserver un pouvoir de monopole dans le serveur de publications publicitaires et dans les marchés d’échanges de publicités sur internet ».
Un constat accablant qui vient confirmer les accusations portées par l’administration Biden, qui avait assigné le géant technologique en janvier 2023 devant un tribunal fédéral de Virginie.
Le « triple monopole » de Google : une stratégie d’étranglement du marché
Au cœur de cette affaire se trouve un concept qui a fait mouche auprès des autorités : celui du « triple monopole ».
Contrairement à ce que soutient Google, qui affirme opérer sur un marché unique à double face pour les annonces numériques (le mettant en concurrence avec des entreprises comme Meta ou TikTok), le Département de la Justice américain (DOJ) identifie trois marchés distincts sur lesquels Google exercerait une domination écrasante.
« Google est une fois, deux fois, trois fois un monopoliste », a martelé le représentant du ministère de la Justice, lors des audiences. Cette formule percutante résume la position du gouvernement américain : Google contrôlerait simultanément les serveurs publicitaires pour éditeurs, les bourses d’échange publicitaire (ad exchanges) et les réseaux publicitaires pour annonceurs.
Une position unique qui lui permettrait d’imposer ses conditions à l’ensemble de l’écosystème.
La juge a notamment relevé que « pendant plus d’une décennie, Google a lié son serveur de publication de publicités et les échanges de publicités à travers des clauses contractuelles et une intégration technologique ».
Cette stratégie aurait permis à l’entreprise « d’établir et de protéger sa position monopolistique dans ces deux marchés ». Plus grave encore, Google aurait « assuré son monopole en imposant des politiques anticoncurrentielles à ses clients et en éliminant des caractéristiques favorables de certains produits ».
Parmi les pratiques pointées du doigt figurent les « Unified Pricing Rules » (UPR), des règles qui empêchaient les éditeurs de fixer des prix plus élevés. Une pratique que seul un acteur en position dominante pouvait imposer, selon le DOJ.
Google conteste et annonce faire appel
Sans surprise, Google a immédiatement contesté cette décision et annoncé son intention de faire appel.
« Nous avons remporté la moitié de cette affaire et nous allons faire appel concernant l’autre moitié », a déclaré Lee-Anne Mulholland, vice-présidente de Google, dans un communiqué transmis à l’AFP. « Nous sommes en désaccord avec la décision du tribunal concernant nos outils d’éditeur », a-t-elle ajouté.
La défense de Google repose sur deux arguments principaux.
D’une part, l’entreprise s’appuie sur le précédent juridique « Ohio v. American Express » (2018), une décision de la Cour suprême concernant les marchés à double face, pour affirmer qu’il n’existe qu’un seul marché publicitaire numérique.
D’autre part, Google invoque la décision « Verizon v. Trinko », qui stipule que les entreprises ne sont généralement pas obligées de traiter avec leurs concurrents.
Cependant, la juge Brinkema semble peu convaincue par ces arguments.
Concernant le précédent American Express, elle a déclaré lors des plaidoiries finales : « J’ai lu cette affaire AmEx plus de fois que je ne l’aurais probablement dû. Nous avons affaire à une configuration complètement différente, me semble-t-il. »
L’avocate de Google, Karen Dunn, avait dénoncé une interprétation erronée du droit par le ministère de la Justice. Selon elle, l’affaire serait basée sur une vision dépassée d’internet, ignorant le contexte actuel où les publicités sont aussi placées dans les résultats de recherche, les applications mobiles et les réseaux sociaux.
Une affaire qui s’inscrit dans un contexte mondial de régulation
Cette décision américaine ne survient pas dans un vide juridique. Elle s’inscrit dans un mouvement mondial de régulation des géants technologiques, particulièrement en matière de concurrence. Au Royaume-Uni, Google fait également l’objet d’une action de groupe similaire, déposée auprès du Competition Appeal Tribunal par le cabinet Geradin Partner.
Cette procédure britannique, annoncée mercredi dernier, est menée au nom de « centaines de milliers » d’entreprises et organisations qui ont payé pour être mieux référencées dans les résultats de Google depuis 2011.
Les plaignants soutiennent (avec raison) que Google s’est assuré d’être « le seul moyen viable de faire de la publicité » sur son moteur de recherche, ce qui lui permettrait de « facturer aux annonceurs des prix plus élevés ».
L’autorité britannique de la concurrence, la CMA, a également lancé en janvier une enquête sur le moteur de recherche de Google. Cette investigation pourrait aboutir à la désignation du géant américain comme « société stratégique sur le marché », un statut qui lui imposerait des exigences particulières en vertu d’un nouveau régime sur le numérique entré en vigueur le 1er janvier.
Ce régime britannique est similaire au Règlement sur les marchés numériques (« Digital Markets Act », DMA) de l’Union européenne, que doivent respecter une poignée de géants des technologies dont Apple, Google et Meta. Le DMA vise explicitement à mettre un terme aux abus de position dominante dans le secteur numérique.
Des conséquences potentiellement majeures pour l’écosystème publicitaire
La juge a donné 7 jours aux parties pour lui remettre un calendrier pour la suite de la procédure, afin de déterminer les « remèdes » à cette situation. Si la décision est confirmée en appel, les conséquences pourraient être considérables pour Google, mais aussi pour l’ensemble de l’écosystème publicitaire en ligne.
Le gouvernement américain avait notamment accusé Google de contrôler le marché des bannières publicitaires sur les sites web, y compris ceux de nombreux médias, et d’en profiter pour pratiquer des prix artificiellement élevés et un partage des revenus inéquitable. Des pratiques qui auraient causé des « dommages importants » aux clients de Google et empêché ses rivaux de lui faire concurrence, selon la juge.
Cette affaire n’est pas la seule à laquelle Google doit faire face. Dans un autre procès, le jury d’un tribunal fédéral de Washington a reconnu Google coupable de pratiques anticoncurrentielles dans la recherche sur internet. Le magistrat doit encore statuer sur les contraintes à imposer au géant technologique.
Une nouvelle ère pour la publicité en ligne ?
Cette décision pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour la publicité en ligne. Si Google est contraint de modifier en profondeur son modèle économique et ses pratiques commerciales, c’est tout l’écosystème publicitaire numérique qui pourrait s’en trouver transformé.
Les éditeurs de contenu, qui dépendent largement des revenus publicitaires pour financer leurs activités, pourraient potentiellement bénéficier d’une plus grande concurrence et de meilleures conditions. Les annonceurs, quant à eux, pourraient voir émerger de nouvelles alternatives à Google, avec potentiellement des tarifs plus compétitifs.
Cependant, la transition ne serait pas sans douleur. Google a construit un écosystème publicitaire profondément intégré, et de nombreux acteurs se sont adaptés à ses règles et à ses outils. Un démantèlement ou une réorganisation majeure pourrait créer des perturbations significatives à court terme.
Quoi qu’il en soit, cette décision marque un tournant dans la relation entre les autorités de régulation et les géants technologiques. Après des années de croissance quasi incontrôlée, ces derniers font désormais face à un examen minutieux de leurs pratiques commerciales, avec des conséquences potentiellement majeures pour leur modèle économique.
Pour Google, dont les revenus publicitaires représentent une part écrasante de son chiffre d’affaires, l’enjeu est considérable. La bataille juridique ne fait que commencer, mais elle pourrait bien redessiner les contours du paysage numérique mondial dans les années à venir.